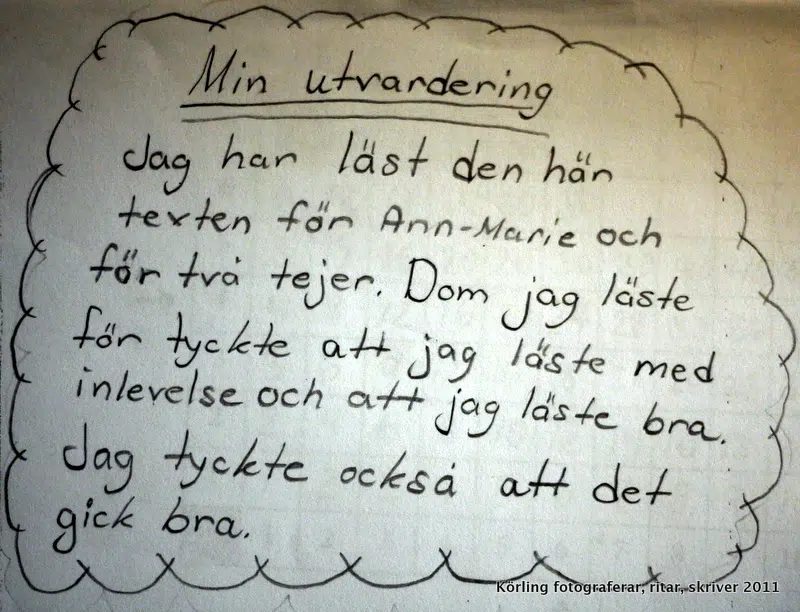La détresse psychique ne se résume pas à une courbe statistique ou à une préoccupation passagère. En Suède, les chiffres parlent d’eux-mêmes : jamais autant d’enfants et d’adolescents n’ont frappé à la porte des services de psychiatrie, ni sollicité d’aide après s’être fait du mal. Depuis les années 1990, la demande explose, tout comme les actes d’automutilation, forçant l’OCDE à pointer du doigt l’insuffisance des moyens consacrés à la santé mentale des élèves. Derrière les rapports et les recommandations, il y a la réalité brute : prévenir la souffrance psychique des jeunes, c’est alléger leur fardeau et, simultanément, limiter l’impact sur la collectivité.
Pour répondre à l’urgence, de nombreux établissements scolaires ont choisi d’intégrer l’apprentissage des « compétences de vie » à leur programme. L’idée : freiner la montée des troubles psychiques par l’éducation et la prévention. Mais cette démarche n’a pas fait l’unanimité. Les débats politiques se sont enflammés, certains dénonçant ce qu’ils qualifient d’« école de flum ». Des critiques sont même venues du SBU (State Medical Evaluation Preparation), qui reproche aux écoles de lancer des programmes dont l’efficacité reste inconnue.
Programmes anti-stress à évaluer
Parmi les dispositifs mis en place, un programme revient souvent : Disa. Son objectif affiché est clair. Disa veut aider les adolescents à mieux gérer leur stress et à prévenir l’apparition de symptômes dépressifs. Le fonctionnement est simple, mais structuré : pendant dix semaines, des groupes se réunissent sous l’encadrement de membres du personnel scolaire, cela peut être la conseillère, l’infirmière ou un responsable des activités périscolaires. Les jeunes y apprennent à exprimer ce qu’ils ressentent, à repérer les pensées qui les boostent ou les freinent, à transformer leur discours intérieur négatif. En d’autres termes, Disa leur propose une initiation à la thérapie cognitive et comportementale, adaptée à leur âge.
Ce programme a vu le jour aux États-Unis, où il a été testé dans des conditions rigoureuses. Pourtant, la version suédoise manque d’assises scientifiques solides. Pour combler ce vide, les universités de Kristianstad et de Lund ont lancé une étude de quatre ans afin d’évaluer l’impact réel de Disa sur les élèves suédois.
La démarche est méthodique. Des élèves de 8e année participant à Disa remplissent des questionnaires sur leur santé psychique avant, juste après et un an après le programme. Ceux qui ne participent pas servent de groupe de comparaison. Plusieurs municipalités ont accepté de jouer le jeu : Kalmar, Stenungsund, Höganäs, Tomelilla et Åhus. Parallèlement, des entretiens sont menés auprès des élèves et de leurs encadrants pour recueillir leurs retours d’expérience.
Meilleur effet sur les filles
Une enquête pilote, menée récemment sur une soixantaine d’élèves, livre ses premiers enseignements. Après la session Disa, l’état psychique des participants s’est globalement amélioré, chez les filles comme chez les garçons. Mais un an plus tard, seuls les bénéfices pour les filles semblent tenir la distance. À l’origine, les garçons affichaient déjà un meilleur équilibre psychologique ; après le programme, les filles atteignent leur niveau. L’accueil général est positif, mais là encore, la différence entre les sexes ressort : les filles jugent le programme plus bénéfique que les garçons.
Ce constat invite à s’interroger. Disa, lors de son arrivée en Suède au début des années 2000, ciblait spécifiquement les adolescentes. Cela se ressent dans le choix des thèmes abordés et les exemples utilisés. Rien d’étonnant alors à ce que les jeunes filles s’y retrouvent davantage.
Le manque d’évaluations sérieuses sur ces programmes de prévention en milieu scolaire reste un point faible en Suède. Le Conseil social et le SBU réclament des études pour mesurer l’efficacité réelle de ces dispositifs. Face à des ressources publiques limitées, il devient impératif de s’assurer que chaque couronne investie serve au mieux les jeunes générations.
Texte : PERNILLAGAR